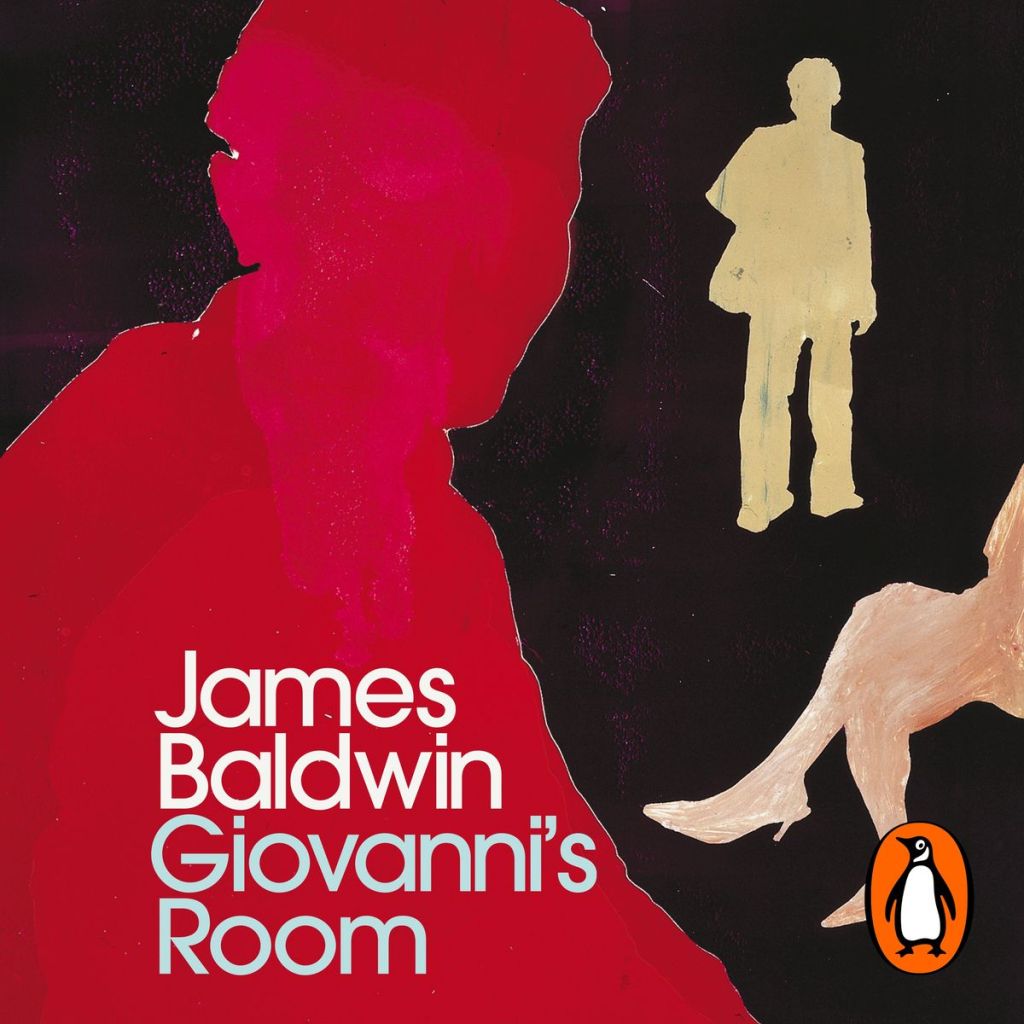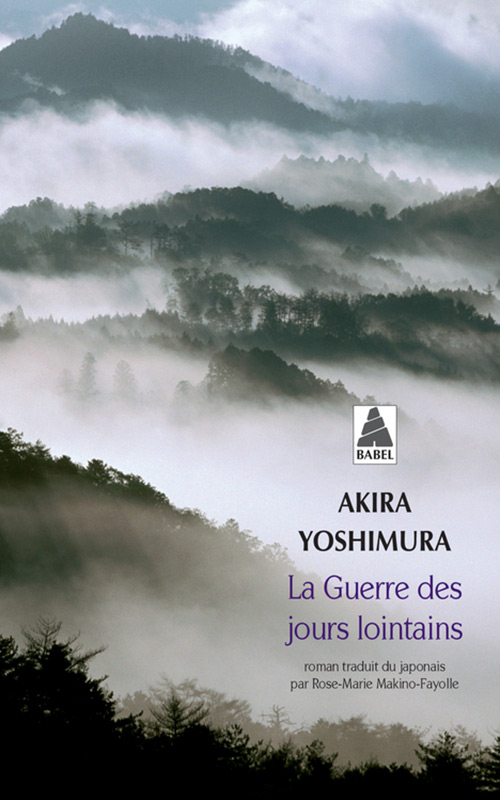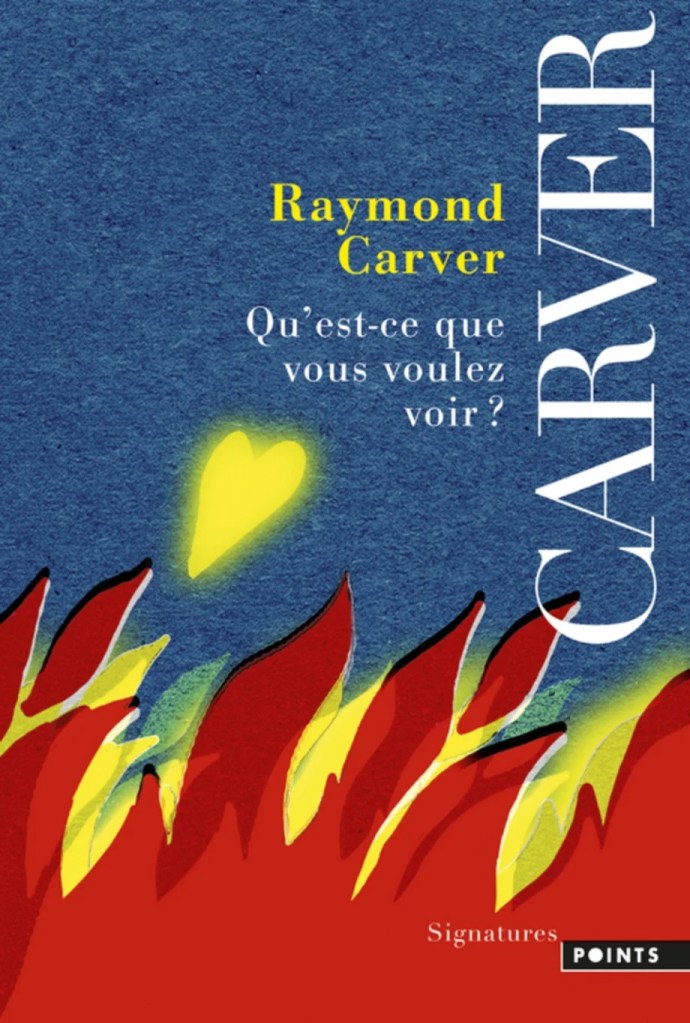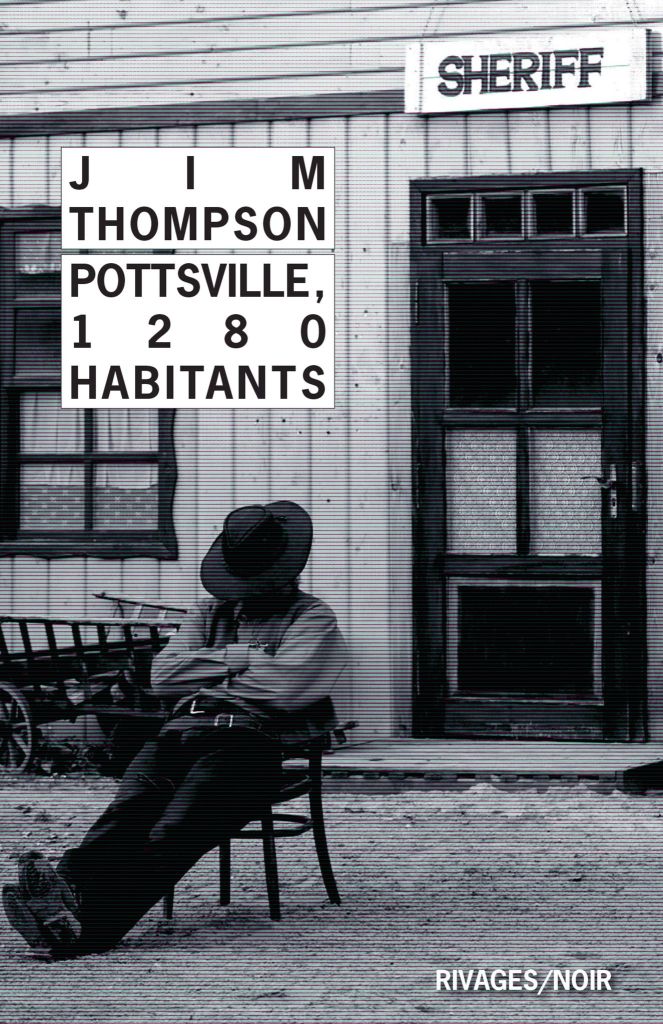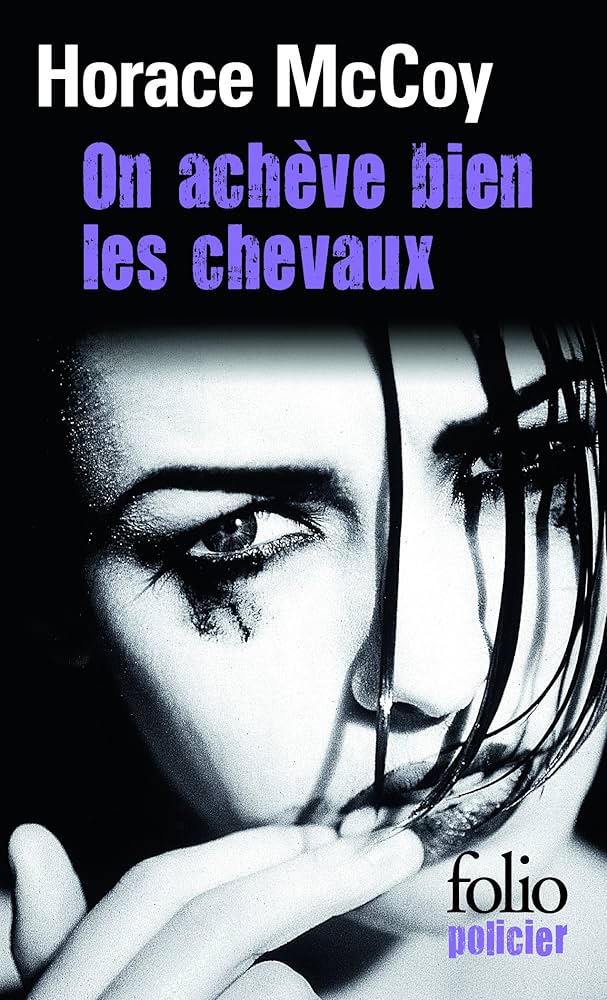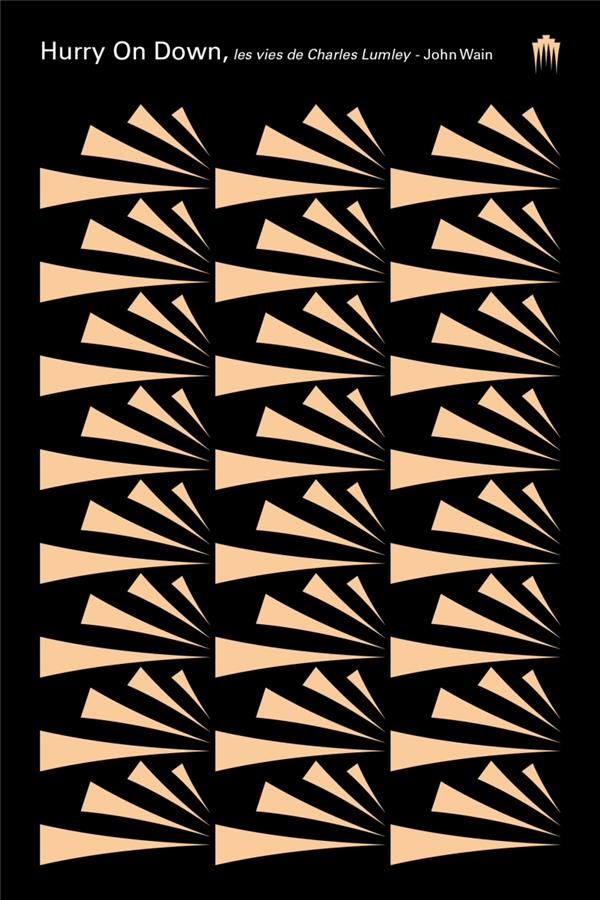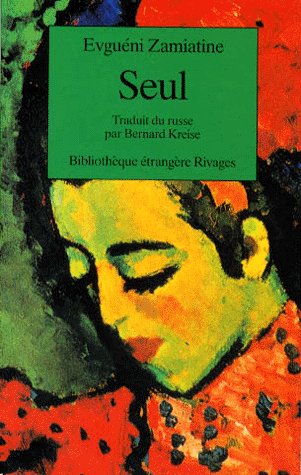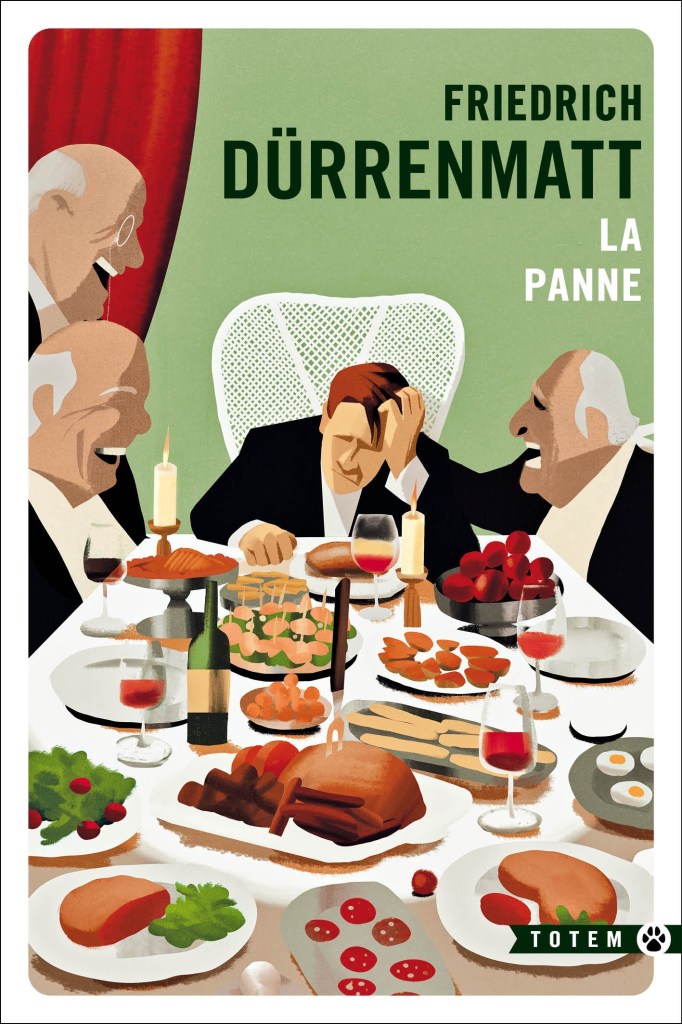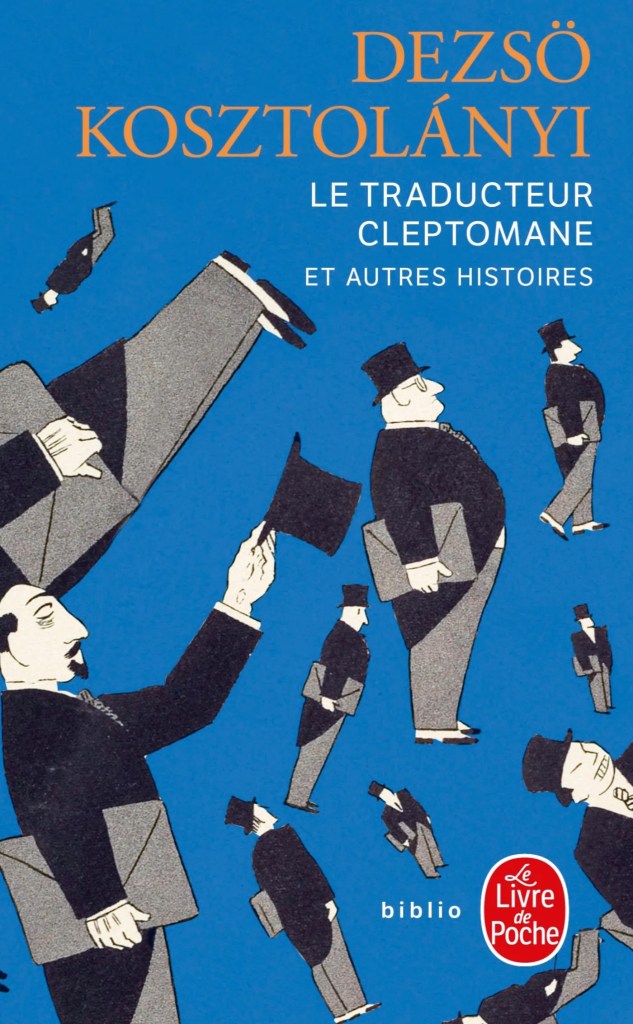
Le traducteur cleptomane, de Dezső Kosztolányi, a été pour moi une véritable rencontre — tant sur le fond que sur la forme. Par la fraîcheur des thèmes abordés, l’étrangeté du regard, la douceur des descriptions et le charme d’une écriture difficilement comparable, Kosztolányi s’est imposé à moi grâce à une recommandation des libraires d’Ombres Blanches. Il est devenu depuis l’un de mes auteurs de nouvelles préférés.
Kosztolányi conçoit la nouvelle comme un matériau à part entière. Contrairement à certains auteurs plus classiques de la scène hongroise, il élabore ses récits sur plusieurs plans simultanés. Les onze nouvelles du Traducteur cleptomane parues en 1933 originellement sont ainsi reliées par un fil rouge : le personnage de Kornél Esti apparaît dans chacune d’elles, double du narrateur — alter ego, diront certains critiques. Pour ma part, je vois plutôt en lui une figure d’un « autre littéraire » : un filtre, une distance avec le réel, qui permet d’embarquer le lecteur dans chaque récit tout en gardant une cohérence globale (le cycle de Kornél Esti continuant dans d’autres ouvrages).
Sur un plan historique, c’est aussi par cette ouverture au monde — incarnée notamment par la création de la revue Nyugat (« Occident ») — que Kosztolányi se distingue d’une intelligentsia hongroise encore repliée sur elle-même. À l’instar de Tchekhov, qui, par ses voyages et ses influences venues d’Europe de l’Ouest, a su renouveler sa manière de faire vivre les personnages jusqu’aux confins du récit, Kosztolányi refuse toute limitation dans les procédés littéraires : variations de point de vue, distorsions temporelles, figures symboliques, récits enchâssés, méta-récits.
Le Traducteur cleptomane est un kaléidoscope d’images et d’émotions, articulées autour du rapport entre le temps et le langage. Kornél Esti intervient tour à tour comme témoin direct ou indirect de scènes quotidiennes, ou d’événements à la lisière du surréel. Ce qui frappe, c’est ce regard constamment décalé sur une société parfois cruellement humaine — comme dans La Disparition, avec le personnage de Kálmán Kernel et les conséquences imprévues de sa fugue imaginée être un suicide par son entourage, puis de son retour parmi les siens. Cette dernière nouvelle m’a immédiatement rappelé Une plaisanterie, de Tchekhov (dans le recueil Une plaisanterie et autres nouvelles, éditions Rivages), qui évoque également la disparition d’un personnage — Nikifor — entraînant une enquête pour homicide, avant de se conclure sur une scène parfaitement absurde et finalement très banale. Ces disparitions, chez Tchekhov comme chez Kosztolányi, révèlent une angoisse humaine fondamentale : le besoin de combler le vide — par la rationalisation, la tristesse ou même la haine.
Ce qui rend Kosztolányi si touchant, c’est ce regard tour à tour drôle, doux, bienveillant et mélancolique. Jamais je n’ai eu l’impression de lire un auteur cynique. Esti, comme son créateur, peut être violent, inquiet, désespéré parfois — mais il reste surtout, la plupart du temps, émerveillé par ce qui échappe en l’homme. Ainsi, dans Le Contrôleur bulgare, un personnage prétend comprendre une langue étrangère : un récit entier se tisse alors dans une langue qu’il ne comprend pas, par le biais des gestes, expressions, objets du quotidien. Ou encore dans Le Président, véritable chef-d’œuvre drôle et bouleversant, retraçant le quotidien d’un président dormant lors de chacune des séances de son association culturelle, qui par son effacement laisse toute la place aux autres. On y lit un questionnement sur le rôle du pouvoir, du chef, et sur la sagesse de l’effacement.
Kosztolányi parvient à saisir cette part d’invisible, d’insaisissable, à travers une expérience littéraire d’une rare acuité. Il donne à voir ce que Cartier-Bresson, reprenant les mots du cardinal de Retz, appelait l’instant décisif : le surgissement inexplicable d’un détail ou d’un geste absurde, révélateur de la vie dans sa brèche.
Le temps est chez lui une matière vivante, un décor mouvant sur lequel se greffent les histoires d’Esti. Il structure les récits en passant d’une durée à une attente, d’un désir à une angoisse, d’une peur à une accalmie. Ce lien entre temporalité et langage forme la base d’une véritable théorie littéraire — non pas abstraite ou universitaire, mais sensible, incarnée, vécue. En cela, il est proche des peintres de son époque, qui élaboraient leur propre théorie en parallèle de leur pratique.
Kosztolányi aborde ainsi les grands questionnements de la modernité : la mort, la morale, le désir, l’argent, la société — toujours à travers cette figure de l’ »autre littéraire », qui permet de maintenir ce que Schopenhauer puis plus tard Freud appelleront le dilemme des hérissons, la bonne distance : ni trop près, ni trop loin des autres. Kosztolányi n’est pas pessimiste, mais tragique. Conscient des failles humaines, de la violence sociale, il cherche par l’écriture à éviter le face-à-face brutal avec la société. Car même dans La Disparition, son personnage Kálmán Kernel est d’abord pleuré, puis haï — précisément pour avoir échappé aux hommes. Les actes sont inutiles, seule compte la sublimation. Car seule l’écriture peut canaliser cette violence précisément car elle met à distance.
Kosztolányi excelle dans la forme courte, qu’il explore presque mystiquement dans les dernières années de sa vie, lors de sa « révolution littéraire ». Il n’écrit plus que des fragments. En cela, il est l’héritier d’un esprit profondément avant-gardiste. Alors que les productions littéraires de la fin du XIXe siècle s’épaississent, il revient à l’essentiel : une écriture dense, brève, où chaque nouvelle devient une fenêtre ouverte sur un monde à part. Par ce retour au court, il anticipe une écriture révolutionnaire et cinématographique : descriptions réduites à l’essentiel, phrases brèves, atmosphères fortes. Un regard déjà en avance sur son temps, et sur une certaine manière d’habiter le monde.
Dezső Kosztolányi, Le traducteur cleptomane et autres histoires, Le Livre de Poche, 2020. Traduction conjointe Maurice Regnaut ; postface Ádam Péter, 224p.
A fine